Des décisions arbitraires, une forte demande dans les programmes d’immigration et les retards accumulés poussent les étudiants et les travailleurs étrangers ainsi que les réfugiés à présenter une demande dans la catégorie des considérations d’ordre humanitaire (CH) comme dernier recours afin de rester au Canada. Cependant, rares sont ceux qui obtiennent une décision favorable, car de nombreux obstacles se dressent sur leur chemin.
Angie Sanchez est arrivée à Montréal en septembre 2022 en tant qu’étudiante internationale avec son mari et ses deux enfants. Ils ont décidé d’émigrer de Colombie, leur pays d’origine, afin de trouver un endroit où leurs enfants pourraient grandir en sécurité.
« D’abord, c’est pour la sécurité des enfants. C’était le facteur principal. Ensuite, parce que nous voulions changer de mode de vie, avoir une vie plus calme – moins de stress et de chaos –, et enfin, parce que nous voulions interagir avec différents types de personnes », explique Mme Sanchez.
Avant d’émigrer, elle et son mari envisageaient l’Espagne ou les États-Unis, en plus du Canada, car ils ont de la famille dans ces pays.
« Lorsque nous réfléchissions à différentes options pour quitter le pays, nous voulions trouver un moyen de le faire correctement, légalement. À cette époque, le Canada, avec son programme pour les étudiants, était l’option qui nous attirait le plus », explique Mme Sanchez.
Ce qui était intéressant, pour Angie et sa famille, c’est que les étudiants étrangers au Canada peuvent étudier tout en travaillant jusqu’à 24 heures par semaine hors campus. Ils ont aussi le droit d’être accompagnés de leurs enfants, qui peuvent poursuivre leurs études à l’école, et de leur époux ou conjoint de fait, qui peut travailler à temps plein pour n’importe quel employeur au Canada grâce à un permis de travail ouvert.
Après avoir pris la décision de venir à Montréal, Angie Sanchez a déposé une demande de permis d’études, un document fédéral qui permet aux ressortissants étrangers d’étudier dans des établissements d’enseignement désignés. Elle envisageait de devenir assistante juridique et, à terme, de demander la résidence permanente avec sa famille. « Nous voyions ici davantage de possibilités pour l’avenir », explique-t-elle.
Pendant ses études, elle a demandé une prolongation de son permis d’études. Toutefois, en raison de retards de la part d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), Angie et sa famille se retrouvent aujourd’hui sans statut. Leur dernier recours, pour rester au Canada, était de présenter une demande de résidence permanente dans la catégorie des considérations d’ordre humanitaire (CH).
« Il y avait des erreurs administratives dans mon dossier d’immigration dès le début »

Au départ, Mme Sanchez avait prévu d’étudier en anglais. Cependant, en 2023, le Programme de l’expérience québécoise (PEQ), un moyen d’immigration qui offre une voie rapide aux diplômés et aux travailleurs étrangers souhaitant s’installer au Québec, a déclaré que les candidats intéressés par ce programme devaient être titulaires d’un diplôme d’études en français admissible.
C’est pourquoi Mme Sanchez a concentré tous ses efforts sur l’apprentissage du français et a terminé ses études de secrétariat juridique dans cette langue. Afin de satisfaire aux conditions requises pour demander la résidence permanente, notamment à l’exigence minimale de 1 800 heures d’études, elle devait suivre un programme de formation, une attestation de spécialisation professionnelle (ASP).
Un an après son arrivée au Canada, Angie Sanchez travaillait déjà comme intervenante communautaire en immigration au Centre d’orientation parajuridique et sociale pour immigrants (COPSI), un organisme à but non lucratif situé à Rosemont–La Petite-Patrie qui offre des services aux immigrants et aux réfugiés à faible revenu, en particulier à ceux provenant d’Amérique latine.
Elle a trouvé l’offre dans une publication Facebook du COPSI, qui indiquait que le centre recherchait un agent communautaire en immigration parlant français et espagnol. Comme ses études de secrétaire juridique étaient liées au domaine de l’immigration, elle a postulé pour le poste vacant.
« J’ai fini par travailler dans ce domaine, ou plutôt, je suis restée dans le travail communautaire, parce que ma mère en Colombie a travaillé toute sa vie dans les services sociaux, le domaine communautaire, etc. J’ai donc été très impliquée dans ce type de travail toute ma vie », explique-t-elle.
Son travail au COPSI consiste notamment à soutenir et à aider les personnes dans leurs démarches d’immigration.
En juillet 2024, elle a demandé une prolongation de son permis d’études, car celui-ci allait expirer avant la fin de son programme de formation.
« Selon le site Web [de l’IRCC], lorsque j’ai présenté ma demande, il fallait compter 180 jours pour obtenir une réponse. Cette période de 180 jours est arrivée à échéance le 23 décembre 2024 et, à cette date, je n’avais toujours pas reçu de réponse, poursuit-elle. J’ai appelé les services d’immigration, j’ai envoyé des formulaires en ligne, et tout ce qu’ils m’ont dit, c’est : “Attendez. Vous devez attendre.” Ils m’ont toujours dit que tout allait bien, que tout était en ordre, qu’il fallait simplement attendre. »
Elle téléphonait quotidiennement à IRCC pour vérifier l’état de sa demande. Lors d’un de ces appels, un employé lui a dit que son dossier allait être examiné par un superviseur en raison du retard.
Sept mois après avoir déposé sa demande de prolongation de permis d’études, Angie Sanchez a reçu, en février 2025, une lettre de son établissement d’enseignement, l’École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration (EMICA), l’informant qu’elle ne pouvait pas poursuivre ses études, car son permis d’études avait déjà expiré. Elle était censée terminer ses études en mars 2025.
Mme Sanchez a également demandé une prolongation de son Certificat d’acceptation du Québec (CAQ), car celui-ci allait expirer sans qu’elle ait pu terminer ses études. Il s’agit d’un document d’immigration provincial obligatoire pour les étudiants et les travailleurs internationaux qui ont l’intention de résider temporairement au Québec. Lors du renouvellement du CAQ, les étudiants internationaux doivent présenter une nouvelle demande de permis d’études.
Huit mois après avoir demandé la prolongation de son permis d’études, Angie Sanchez a reçu une lettre d’IRCC l’informant que sa demande avait été rejetée parce que son CAQ avait expiré.
« C’était vraiment frustrant. Après huit mois et huit jours, juste au moment où mon CAQ avait expiré, j’ai reçu une réponse. Leur décision était basée uniquement sur cela », estime Mme Sanchez.
Elle a dû arrêter de travailler au COPSI parce qu’elle a perdu son statut d’étudiante internationale. Son mari a également perdu son permis de travail, car celui-ci était lié à la demande d’Angie, qui était la principale requérante. Leurs enfants ont également perdu leur permis d’études.
Après avoir demandé le rétablissement du statut de sa famille, elle a reçu une nouvelle réponse négative. Dans la lettre que lui a envoyée IRCC, il était indiqué qu’ils ne pouvaient pas valider sa lettre d’admission (LOA) auprès de son école, un document confirmant qu’un étudiant a été accepté dans un établissement canadien. Et ce, malgré le fait qu’elle était inscrite à l’École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration (EMICA) jusqu’à l’expiration de son permis d’études – et qu’elle ait dû interrompre ses études.
Le 28 août 2025, Angie Sanchez et sa famille ont déposé une demande de résidence permanente dans la catégorie des considérations d’ordre humanitaire (CH).
« Il y a eu des erreurs administratives dans mon dossier d’immigration dès le début. Quand je dis “dès le début”, je veux dire dès le moment où j’ai fait ma première demande de visa, poursuit-elle. Lorsque j’ai fait ma première demande de visa étudiant depuis mon pays d’origine, j’ai reçu une lettre de refus, puis une demi-heure plus tard, j’ai reçu une autre lettre [d’IRCC] disant : “Nous nous excusons, il s’agit d’une erreur, veuillez nous envoyer votre passeport.” »
Actuellement, Angie Sanchez et sa famille vivent grâce à leurs économies, qui seront bientôt épuisées. En attendant une réponse à sa demande, elle fait du bénévolat au COPSI, où elle aide les immigrants et les réfugiés à obtenir leurs documents d’immigration.
« Je fais du bénévolat parce que c’est un engagement personnel. J’aime le faire, j’aime aider les gens parce que j’ai réalisé que beaucoup d’entre eux sont confrontés à la barrière de la langue lorsqu’ils cherchent de l’aide, et que souvent, engager un avocat spécialisé en immigration coûte cher, et ils n’ont pas les moyens de le payer », explique Mme Sanchez.
Une bouée de sauvetage
Comme elle, de nombreux étudiants internationaux, travailleurs étrangers et demandeurs d’asile demandent la résidence permanente pour des raisons d’ordre humanitaire. Dans le cas des diplômés et des travailleurs étrangers, beaucoup ne satisfont pas aux conditions requises pour demander la résidence permanente dans le cadre d’autres programmes d’immigration, comme le programme Entrée express, qui attribue un score à chaque individu en fonction de son niveau d’études, de ses connaissances linguistiques, de son expérience professionnelle et de ses compétences, entre autres facteurs.
De plus en plus d’immigrants et de réfugiés qui souhaitent rester au Canada demandent la résidence permanente pour des raisons humanitaires et compassionnelles, car les programmes d’immigration comme Entrée express ou le Programme d’expérience québécoise (PEQ) sont très compétitifs en raison de la forte demande et des critères d’admissibilité stricts. Les demandes d’immigration dans presque toutes les catégories de résidence permanente ou temporaire ont également connu un taux de refus plus élevé depuis 2023.
Dans leur demande soumise dans la catégorie CH, les candidats doivent présenter des raisons suffisantes susceptibles d’éveiller la compassion des agents d’immigration chargés de décider s’ils méritent de rester ou pas au Canada.
« Comment éveiller la compassion ? demande Deana Okun-Nachoff, avocate en chef chez Evolution Immigration Law Group. C’est quelque chose d’assez nébuleux. »
L’avocate explique que les demandes dans la catégorie des considérations d’ordre humanitaire ne sont pas soumises à une liste de critères, contrairement à d’autres programmes d’immigration, comme Entrée express. Les décisions relatives aux demandes pour des raisons d’ordre humanitaire sont subjectives.
Comme l’ont établi des décisions judiciaires antérieures, les demandes de catégorie CH qui devraient être approuvées sont celles qui rendraient « un citoyen canadien moyen ému et [l’amènerait] à essayer de soulager [la] souffrance », expose Me Okun-Nachoff, qui compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’immigration.
Cependant, l’augmentation du nombre de demandes d’asile et la forte concurrence dans d’autres filières d’immigration laissent de nombreuses personnes sans statut dans le pays, ce qui les pousse finalement à présenter une demande dans la catégorie des considérations d’ordre humanitaire.
« C’est comme la dernière bouée de sauvetage dont dispose un immigrant au Canada lorsqu’il n’y a plus d’autres possibilités d’immigration disponibles », explique Angie Sanchez.
Une course vers le bas
Obtenir gain de cause dans le cadre d’une demande d’aide au logement est désormais un défi de taille pour beaucoup de gens.
En 2024, le Canada a considérablement réduit le nombre de personnes pouvant présenter une demande CH. Le Plan des niveaux d’immigration 2025-2027 vise à « stabiliser les niveaux globaux d’immigration et à mieux gérer les programmes de migration », comme l’indique IRCC.
En 2024, IRCC a reçu 13 750 demandes CH. Le cas d’Angie Sanchez fait partie des 10 000 qu’IRCC aura reçus en 2025. Ce nombre continuera à baisser au cours des deux prochaines années. Il passera à 6 900 l’année prochaine, puis à 4 300 en 2027.
Comme l’explique Me Okun-Nachoff, il existe également une limite au nombre de demandes que les agents d’immigration peuvent approuver chaque année, ce qui augmente la probabilité d’essuyer un refus.
« Cela signifie que la liste d’attente est extrêmement longue, et maintenant, avec les faibles quotas de personnes traitées chaque année, le temps d’attente est encore plus long. Il faut donc compter six ou sept ans entre le dépôt de la demande et l’obtention d’une réponse théorique », explique Mary Foster, organisatrice communautaire de Solidarity Across Borders, un réseau qui défend les droits des migrants.
Le temps d’attente plus long est également dû à la stratégie actuelle du bureau de l’immigration, qui consiste à réduire d’environ un quart ses effectifs au cours des trois prochaines années afin de diminuer les dépenses et de revenir à la dotation en personnel d’avant la pandémie. De plus, comme chaque agent d’immigration doit composer avec la pression de rendre une décision dans un délai court afin d’éviter une accumulation des dossiers en attente, cela peut conduire à des décisions prises à la hâte.
Pénurie de compassion
Me Okun-Nachoff, qui est également co-animatrice de Borderlines, un balado sur les lois et politiques canadiennes en matière d’immigration, mentionne dans l’un des épisodes de Borderlines qu’une demande viable dans la catégorie des considérations d’ordre humanitaire est une demande qui ferait « pleurer l’agent d’immigration ».
« Cela pousse les gens à créer des récits sur leur vie, récits dans lesquels il y a un superhéros qui est aussi une victime, mais qui parvient à s’élever au-dessus de son statut de victime pour devenir un super-migrant, [montrant] que c’est pour cela qu’ils sont bons et que le Canada blanc devrait les laisser entrer », image Mme Foster.
Un autre élément qui contribue à cette situation catastrophique est le fait que les migrants et les demandeurs d’asile sont actuellement soumis à un examen plus rigoureux et à des obstacles plus importants pour obtenir un statut. Le système d’immigration actuel a transformé les demandes CH en une compétition visant à déterminer quels cas méritent le plus d’attention.
« C’est comme une course vers le bas. Beaucoup de personnes qui souhaitent présenter ce type de demande ne sont pas vraiment d’accord avec l’idée de se présenter comme des victimes afin d’obtenir un statut, et c’est en partie pour cette raison que beaucoup de mes clients ne souhaitent pas demander le statut de réfugié, car ils se sentent stigmatisés », rapporte Me Okun-Nachoff.
Les demandes CH sont en hausse en raison des multiples conflits qui sévissent ailleurs dans le monde et des défis socio-économiques auxquels de nombreuses personnes sont actuellement confrontées. À cela s’ajoute le plafonnement du nombre de demandes CH acceptées, ce qui rend de nombreux agents d’immigration plus sévères lors de l’examen des demandes, comme l’explique Me Okun-Nachoff.
« La sympathie semble désormais faire défaut. Alors que les demandes augmentent, les ressources sont limitées, et notre sympathie pour nos semblables a tendance à diminuer, car les êtres humains sont égoïstes par nature », déplore l’avocat Raj Sharma dans l’épisode de Borderlines dont nous avons déjà parlé.
Absence d’autres voies de migration
Pour Me Okun-Nachoff, le Canada a progressivement changé son discours sur la migration. À ses yeux, ce qui était autrefois un pays accueillant pour les réfugiés et les nouveaux arrivants est désormais réduit à des chiffres.
« On considère tout cela d’une manière binaire très étrange. Il n’y a plus aucune sophistication, contrairement à ce que j’ai pu ressentir autrefois. Je pense que nous avons commencé à nous livrer à cet étrange jeu consistant à déterminer “qui vaut le plus”, ce qui me semble très trumpien », regrette l’avocate.
Elle raconte que, presque tous les jours, elle est contactée par quelqu’un qui souhaite présenter une demande CH, mais qui ne remplit pas les conditions requises.
« Je suis contactée par des médecins, des infirmières, des scientifiques spécialisés dans le changement climatique, des personnes titulaires de diplômes universitaires supérieurs, dont beaucoup ont obtenu un degré de formation élevé au Canada, et ces personnes ne satisfont pas aux conditions requises pour obtenir la résidence permanente », poursuit Me Okun-Nachoff. « En revanche, le Canada invite un grand nombre de personnes qui vivent peut-être à l’étranger, mais qui parlent un minimum de français, et celles-ci devancent des candidats comme ceux que j’ai décrits. »
Elle s’inquiète aussi du fait que la majorité des programmes de résidence permanente sont axés sur les catégories économiques et laissent de côté d’autres migrants, comme les personnes qui sont arrivées dans le cadre d’initiatives comme l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (CUAET).
« Plus de 150 000 personnes ont été invitées à le faire, et aujourd’hui, elles n’ont aucun moyen d’obtenir la résidence permanente. Pendant ce temps, le conflit se poursuit en Ukraine. Alors, que sont-elles censées faire ? » s’interroge Me Okun-Nachoff.
Mme Foster explique que cette absence de solutions pousse finalement les gens à vivre sans statut dans le pays après avoir épuisé leur dernier recours en matière d’immigration.
« Pour beaucoup de gens, lorsqu’ils obtiennent enfin une réponse, celle-ci est négative. Que font-ils alors ? Ils doivent rester sur place pour recommencer à zéro, abandonner ou vivre sans papiers pour toujours, poursuit l’organisatrice communautaire. C’est pourquoi nous faisons pression pour obtenir un programme de régularisation, car un nombre considérable de personnes vivent dans le besoin. C’est une situation absolument intenable. »
Un programme de régularisation signifierait que tous les immigrants et réfugiés au Canada obtiendraient un statut.
« Depuis le début, depuis plus de 20 ans, nous réclamons un statut pour tous, ce qui signifie que tout le monde devrait désormais bénéficier d’un statut permanent, rappelle Mme Foster. Les demandes [CH] sont présentées comme la solution à un problème qui ne devrait pas exister, d’autant plus qu’il s’agit d’un programme extrêmement complexe et contraignant qui fait peser tout le fardeau sur la personne concernée.»
Pour avoir de meilleures chances d’obtenir gain de cause dans une demande CH, Mme Foster affirme qu’il est important de faire appel à un avocat. Cependant, de nombreux immigrants n’ont pas les moyens de s’en offrir un. Dans ce type de situation, les honoraires moyens d’un avocat spécialisé en immigration s’élèvent à environ 8 000 $, ce qui constitue un obstacle supplémentaire pour les personnes qui souhaitent obtenir un statut au Canada.
« La personne sans-papiers, par définition, n’a pas les moyens de payer un avocat. Elle a droit à l’aide juridique, mais celle-ci est si peu rémunérée que très peu d’avocats, voire aucun, acceptent désormais de prendre en charge ce type de dossier. Ces demandes représentent énormément de travail. Il faut réunir des preuves, rédiger des rapports, et cela demande beaucoup d’efforts pour bien faire les choses et avoir une chance de réussir », explique Mme Foster.
Ceux et celles qui n’ont pas les moyens de payer un avocat se tournent vers des organisations comme le COPSI, où des employés comme Angie Sanchez les orientent vers des professionnels susceptibles de prendre leur dossier en charge. « J’ai vécu toutes les étapes du parcours des personnes qui viennent me voir ici pour demander de l’aide », raconte Mme Sanchez. Elle sait parfaitement ce qu’elles vivent, attendant elle-même de savoir quel sera son sort.





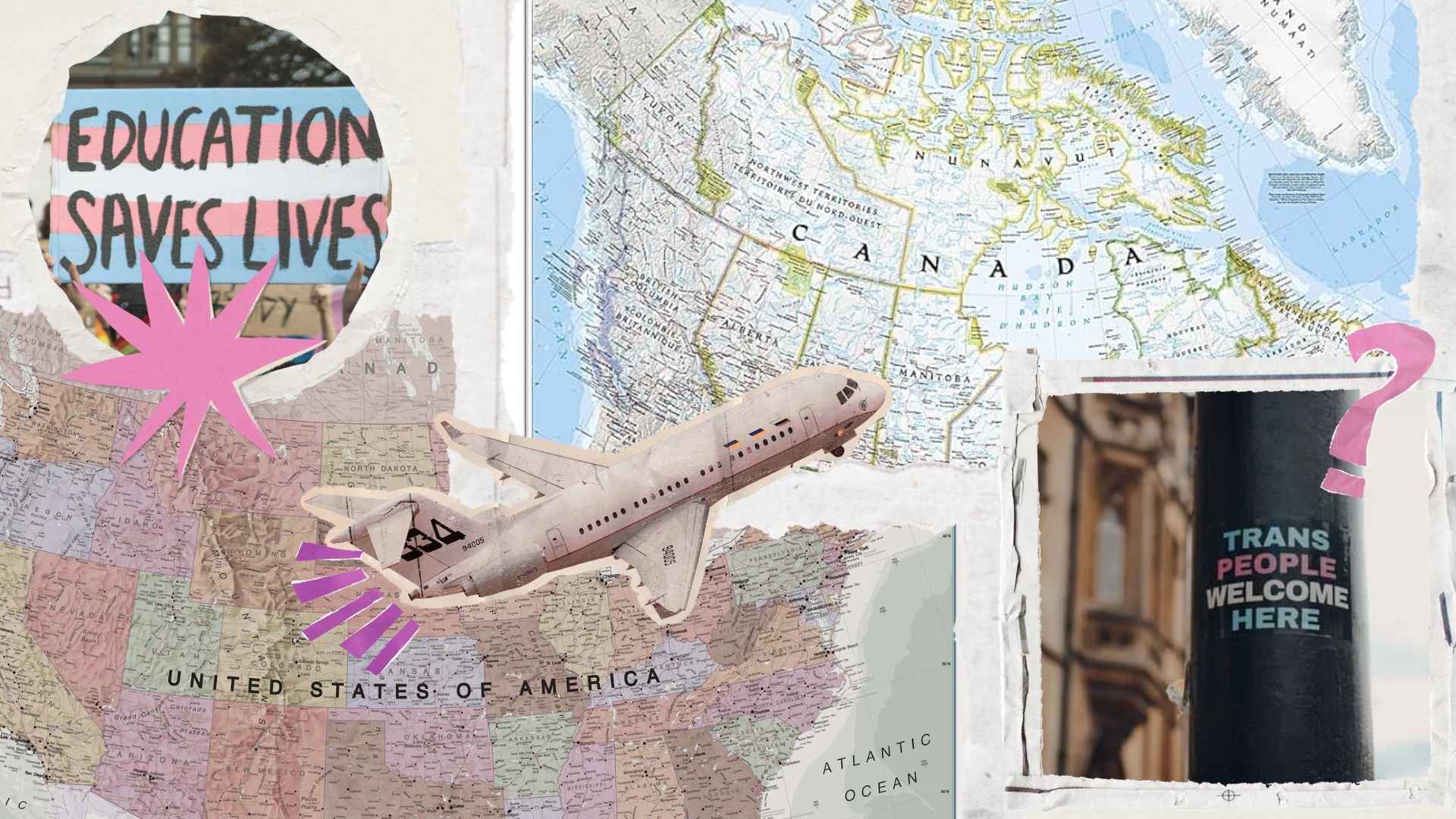
.jpg)
%20(1)%20(1).jpg)
%20(3)%20(1).jpg)