Au Québec et aux États-Unis, les rôles écrits pour les femmes hispaniques reflètent parfois mal la réalité, autant dans les petites que dans les grandes boîtes de productions télévisuelles et cinématographiques. Malgré une évolution positive des personnages écrits pour ces femmes, des critiques sur les stéréotypes mis de l’avant à l’écran perdurent dans le temps. Nous avons rencontré Fatima, une actrice émergente, Carolina*, scénariste, ainsi que Zaira, chercheuse et professeure agrégée à l’Université de Montréal, pour discuter de leurs observations au sein de l’industrie.
Une veste en laine bleue et verte est accrochée sur une chaise du Café des Arts. L’été est pourtant bien entamé, en ce début du mois de juillet. Le veston attend sa propriétaire, Fatima Lopez qui nous a donné rendez-vous ici. Sur l’un des quatre murs qui entourent la clientèle, des tableaux de peinture acrylique sont accrochés, signés Enriqueta Ahrensburg. Fatima revient, prend sa veste et nous nous déplaçons vers une table plus grande, juste derrière.
Âgée de 25 ans et actrice de profession, elle naît à Buenos Aires, en Argentine. Après plusieurs aller-retours entre la capitale de l’Argentine et Montréal, elle et sa famille s’établissent définitivement à Montréal en 2016. Puisqu’elle grandit dans l’Ouest de la ville, la jeune femme s’inscrit au Cégep John Abbott College et étudie dans le programme anglophone d’interprétation théâtrale, avant de terminer une formation à l’École nationale de théâtre du Canada.
Nous l’interrogeons sur ses expériences d’actrice depuis 2021. Elle sort son téléphone de sa poche et ouvre une mine d’or : dans un document Excel, elle a noté tous les rôles pour lesquels elle a été auditionnée depuis l’an dernier, ainsi que la description de tous les personnages qu’elle a interprétés. Un code de couleur permet d’identifier les rôles qu’elle a joués pour le petit ou le grand écran. D’après ses observations, les séries francophones penchent plus vers une représentation séductrice de la femme hispanique. « Je me suis rendue compte que pour les séries [canadiennes] en anglais, il y avait moins de descriptions comme fougueuse, séduisante. C’était plutôt dans les films [canadiens anglophones], que les qualificatifs revenaient : forte, dure, opiniâtre, fougueuse, souligne la jeune actrice, en serrant le poing pour imager ses propos.
Selon Fatima, les places assignées aux femmes latino-américines dans le petit écran sont marquées par un certain fétichisme: accent hispanique, des courbes prononcées, etc. Ce stéréotype, celui de la femme sexy, ne reflète pas la réalité, nous explique-t-elle. « Ça me dérange que quelqu’un dise ‘’les latinas‘’ pour parler des [filles avec un accent et des courbes], résume Fatima, dont le visage s’anime à mesure qu’elle nous décrit ses expériences. Les latinas sont de toutes les formes, genres et types ! »
Elle pointe son cellulaire, posé sur la table, et le fichier qu’elle tient à jour depuis 2024. « De toutes les auditions que j’ai faites pour des personnages latinos, un seul était écrit par une latina, souligne-t-elle, visiblement agacée. C’est de là que viennent les stéréotypes : si quelqu’un qui n’est pas de notre culture écrit les personnages, il aura une perspective différente. Je ne veux pas dire que je ne veux pas que des Caucasiens, Noirs ou Asiatiques n’écrivent pas de rôles pour nous [...], mais il faut de la diversité sur les plateaux, pas seulement devant les caméras ! »
Ses voyages fréquents entre l’Amérique Latine et l’Amérique du Nord l’ont plongée dans des univers cinématographiques très différents. À l’époque, pour elle, les films argentins n’étaient pas aussi « cool que les films américains ». Elle ne consommait pas d'œuvres de son pays d’origine. « Ça m’a empêché d’avoir de l’influence argentine. On a de très bons comédiens, beaucoup de talents, mais je ne les ai pas regardés parce que je voulais être une comédienne américaine [caucasienne], explique-t-elle. En regardant la télé, c'était plutôt les caucasiennes qui avaient le lead. »
C’est l’émission Les sorciers de Waverly Place, où les personnages principaux sont italo-mexicains, qui lui a permis de réaliser qu’il lui était possible de devenir actrice, sans renier ses origines.
Se reconnaître à l’écran
Quelques jours plus tard, nous retrouvons Carolina, une scénariste. Sur l’Avenue Henri-Julien, à Montréal, se trouve l’un des accès du Marché Jean-Talon, qui accueille ses visiteurs en cette journée de juillet où le soleil frappe fort. Un trio d’oiseaux se pose sur le sol et sautille vers le comptoir d’un marchand de tarte, avant de partir à l’envol vers un autre corridor du marché. Carolina nous rejoint à l’une des tables surélevées à l’entrée, couvertes par le plafond. Ses cheveux tressés lui dégagent le visage. Sous son bras, un gros paquet d'œufs qu’elle vient d’acheter cache son sac à main, ligné noir, orange, rose et vert. Nous la rencontrons après lui avoir posé quelques questions au téléphone, sur le sujet qui nous intéresse. Son regard de scénariste latino-américaine expérimentée permet de comprendre le pouvoir qu’ont les équipes de productions cinématographiques et télévisuelles, au moment de la pré-production.
Son constat est sans appel : elle observe qu’au Québec, les rôles pensés pour des femmes hispaniques les représentent souvent comme des femmes humiliées ou qui traversent de grandes souffrances. Déjà dans les années 90, les petits rôles de second plan que les femmes latino-américaines jouaient incarnaient des femmes de ménage, des mères qui pleurent leur fils au palais de justice, ou des victimes d’agression, explique Carolina.
Carolina est tout de même consciente des limites que peuvent rencontrer certaines équipes de production. « C’est très dur d’écrire pour des cultures qu’on ne côtoie pas nécessairement au quotidien, concède-t-elle, les yeux rivés au plafond… Si dans notre entourage, la seule latina c’est une femme de ménage, c’est ça qu’on va mettre. »
.jpeg)
La création des fiches de personnages ne part pas d’une mauvaise intention, précise-t-elle, mais d’un manque d’imagination : « Il y a une femme snob de Westmount qui vient critiquer le personnage principal, parce qu’elle trouve qu’il est pas poli dans un restaurant. Pourquoi est-ce qu’elle ne serait pas latina, elle ? Elle n’est jamais latina. La snob va être blanche ; c’est associé à une classe sociale », constate Carolina.
Sa tresse tombe sur ses épaules et ses doigts se promènent le long de sa chevelure. « Je trouverais ça super de [nous] voir dans d’autres classes sociales, d’être la professeur motivante qui inspire son élève en classe de français, par exemple. Voir [les femmes latinas] dans d’autres rôles de la société serait super valorisant, soutient la scénariste. [...] Ces modèles positifs sont très importants pour la jeunesse. »
Carolina compare la situation avec le monde du théâtre, domaine dans lequel elle travaille aussi. Avant les Québécois, c'était des Français qui foulaient les planches. « C’est quand les Québécois ont commencé à se voir sur la scène, qu’ils se sont reconnus comme peuple. » Ses mains s’agitent devant sa camisole blanche, elles soutiennent ses propos. « C’est pour ça que c’est important de voir des gens de différentes cultures faire partie de la réalité télévisuelle. C’est là où on les inclut dans notre société, c’est en se voyant [qu’ils se diront] qu’ils font partie de notre culture. »
Carolina évoque la série états-unienne Brooklyn 99, adaptée en 2020 au Québec. Une polémique s’en est suivie : dans la série originale, deux détectives sont interprétés par Stephanie Beatriz, née en Argentine, et Melissa Fumero, fille d’un couple cubain. « C’est un exemple parfait, c’est [des] femmes latinas, policières, premières de classe, super intelligentes, un peu ‘’awkward’’... c’est vraiment [des] personnages fantastiques, avec plein de nuances, qui ne se définissent pas du tout par leur origine latina », explique Carolina.
Mais la production québécoise a choisi Mylène Mackay et Bianca Gervais, des actrices qui ne sont pas latinas, pour incarner les deux détectives. « [Les scénaristes] disaient qu’il y avait beaucoup plus de latinos aux États-Unis qu’ici, et qu’ils essayaient de représenter la réalité [québécoise]. Je peux comprendre, c’est pas la même réalité », explique Carolina. En 2020 , la population de New York City compte en effet près de 27% de personnes hispaniques, contre 1,6% pour la Ville de Québec en 2021.
Même si de nombreuses critiques se sont fait entendre au Québec et aux États-Unis suite à cette modification de scénario, cette passionnée d’arts de la scène remarque une amélioration, dans la province, quant à la représentation de la diversité au cinéma et à la télévision. « En ce moment, on est en train de voir comment faire pour que ce soit organique et vrai, mais on est [au Québec] dans la phase ‘’awkward’’ de l'adolescence, où c'est pas encore un produit fini. Il y a encore beaucoup de maladresse, mais la volonté est là, on a avancé dans le cheminement, il faut pas l'oublier », rappelle Carolina.
Le temps file, elle doit bientôt partir à un autre rendez-vous, mais elle peut encore répondre à quelques questions. Durant son temps libre, elle note le nom de jeunes artistes émergents, latinos, la marque par leur jeu. « Il y a une vague [d’artistes] en train de sortir des écoles. Il y a vraiment plus de diversité, ils vont amener une vague de fraîcheur et d'authenticité dans ce qu’ils vont proposer. » Un regard pensif se lit sur son visage. Malgré l'augmentation de la diversité, la précarité dans le monde des métiers artistiques continue d’être un enjeu pour les enfants d’immigrants, ajoute Carolina. « Quand tes parents ont tout sacrifié pour venir dans un nouveau pays, c’est difficile de dire "je vais aller jouer à la loterie avec une job qui sera peut-être pas payé". »
Pour mieux refléter les réalités des communautés décrites dans des films et séries, un travail de recherche est de mise, explique la scénariste. « C’est notre job de faire ce qu’on appelle du travail de personnage, pour le complexifier, le rendre réel. Je me renseigne le plus possible. Si c’est basé sur une culture que je connais moins, je regarde des documentaires, j'essaie de lire des livres de la culture, de me renseigner le plus possible pour être… vrai. »
« Le cinéma de chaque pays commence par l’éducation »
Près d’une semaine plus tard, Zaira Zarza, professeure agrégée du département d’histoire de l’art, de cinéma et des médias audiovisuels de l’Université de Montréal, nous rejoint en cession Zoom. Ses cheveux courts et noirs tracent le contour de son visage et se marient avec ses yeux bruns foncés.

À peine l’entrevue débutée, Zaira énumère, avec enthousiasme, des références cinématographiques Le coyote et Les routes de février qui ont été réalisés par Katherine Jerkovic, originaire d’Uruguay, d’Argentine et de Croatie. Ce dernier constitue le premier film québécois filmé en Uruguay et en espagnol. Mis dos voces, par Lina Rodriguez, a été entièrement filmé au Canada. Ces trois long-métrages acclamés au niveau national sont intimement ancrés dans l’experience de vie latino-canadienne et valorisent des actrices originaires d’Amérique Latine. « C’est cette intimité, cette vulnérabilité qu'[on retrouve] dans [leurs] personnages qui font vraiment de leur cinéma une représentation, à mon avis, la plus authentique, la plus honnête, de la réalité des personnes immigrantes, et surtout des femmes », raconte Zaira, le regard plongé devant l’écran de son ordinateur.
La chercheuse fait un survol de la situation au États-Unis, et compte sur les doigts d’une main les actrices hispano-américaines souvent présentes à l’écran. « Est-ce qu’on voit beaucoup de représentations de femmes ou de réalisatrices d'origines latino-américaines ? Non. Est-ce qu'on les voit partout dans les médias ? Est-ce qu'elles sont en mainstream ? Est-ce qu’elles ont un espace à Hollywood ? Non. » D’après une étude menée en 2019 par l’USC Annenberg School portant sur 1200 films réalisés entre 2007 et 2018, seulement 19 productrices hispaniques étaient recensées. De plus, 4% des réalisateurs étaient des latinos. Sur ce total, il n’y avait qu’une seule réalisatrice hispano-américaine.
Selon Zaira, de nombreuses barrières se dressent pour les personnes immigrantes qui veulent se lancer dans ce métier, dans un nouveau pays. « C’est difficile pour les personnes d'origine canadienne et québécoise, imaginez ceux pour qui le français ou l’anglais n’est pas leur langue maternelle, qui ne connaissent pas vraiment le système des films comme la SODEC, Québecor, l'Office National du Film et d'autres institutions qui financent le cinéma et les médias. Ce sont des formes d’arts pour lesquelles il faut absolument du financement », rapporte-t-elle, d’un ton empathique.
Au Québec et aux États-Unis, les cinéastes dépendent grandement, poursuit-elle, des politiques culturelles de financement. Ce sont des décisions gouvernementales qui permettent de rendre visibles, ou non, les scénaristes qui abordent des sujets sociaux et politiques. C’est ce qu’on a pu observer suite aux luttes sociales liées aux mouvements de George Floyd et #MeToo, précise Zaira. « Il y a eu des financements pour les producteurs racisés, pour les communautés des cinéastes autochtones, qui, avant, avaient [...] très peu de possibilités de rentrer dans les concours. [...] Mais ces mesures continuent d’être cosmétiques [...] : Dans un monde idéal, ce type de concours ne devrait pas exister. »
Il ne reste plus que sept minutes avant que la plateforme coupe notre appel. Son regard se balade dans la pièce où elle se trouve, dans le confort de sa maison. Ses yeux se posent sur notre appel vidéo. Pour cette professeure expérimentée, une chose est claire : tout commence sur les bancs d’école. « Le cinéma de chaque pays, à mon avis, commence par l'éducation. [Si] je ne vois pas un étudiant autochtone dans la salle de classe à l'Université de Montréal, pas de femmes d'origine latino-américaine, je peux imaginer ce qui va manquer dans les écrans, dans le futur », déclare-t-elle. Il est primordial d’attirer des étudiants de divers groupes de minorités visibles dans le monde des arts, de la culture et des médias. « C’est difficile, parce que [ce sont] en général des carrières très privilégiées, élitistes, […] il faut vraiment faire tomber ce mur par rapport aux arts ! »
*Prénom fictif utilisé pour assurer l’anonymat.




.jpeg)
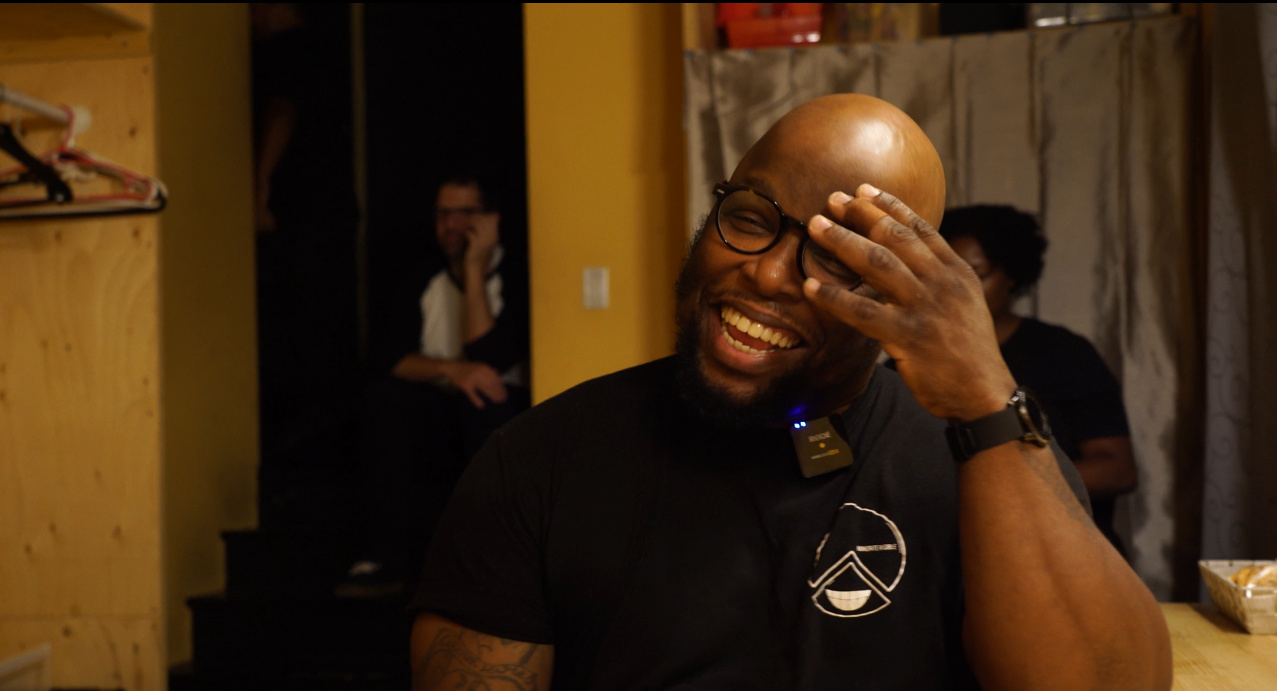
.jpeg)

.png)
.jpg)
%20(1).jpg)